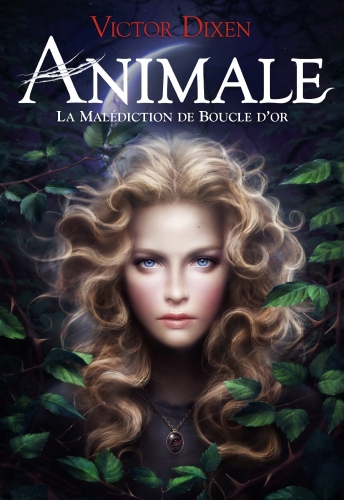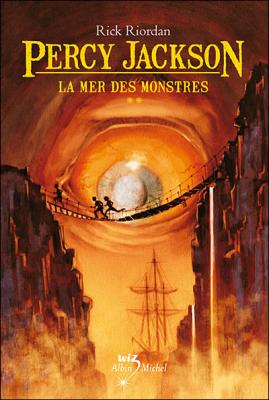Les fausses bonnes questions de Lemony
Snicket 1
Mais qui cela peut-il être à cette
heure ?
Editions Nathan / 250 pages
Quatrième de couverture :
Avant de lire ce livre, il serait
préférable de vous poser ces questions :
1- Voulez-vous savoir ce qui se passe
dans une ville en bord de mer qui ne se trouve plus en bord de mer ?
2- Voulez-vous en apprendre davantage
sur un objet volé qui n'a pas du tout été volé ?
3- Pensez-vous vraiment que cela vous
regarde ? Pourquoi ? Quelles sont vos motivations ? En êtes-vous sûr
?
4- Qui se tient derrière vous ?
Ma rencontre avec le livre :
Lemony Snicket est une vieille
connaissance puis que je suis un fan inconditionnel de son autre
série, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire.
Lorsque j'ai appris qu'il sortait enfin un nouveau livre, je n'ai pas
hésité longtemps ! Plus qu'une rencontre, il s'agit donc ici
de retrouvailles avec un de mes auteurs favoris !
Ma
lecture du livre :
Quel
plaisir de retrouver après tant d'années l'écriture de Lemony
Snicket ! Le style si particulier de l'auteur est intact. Le
livre est truffé de jeux sur les synonymes, de références
littéraires et surtout de ces tableaux de lieux si atypiques
auxquels l'auteur nous avait habitué dans les orphelins Baudelaire.
Arrêtons-nous
justement sur le cadre de cette histoire. A l'échelle locale,
Snicket nous propose de découvrir une petite ville au bord de la mer
qui n'est plus au bord de la mer. Rien qu'avec cette description, le
ton est donné : tout ce qui vous y attend n'aura ni queue ni
tête ! Mais, à une échelle plus large, on se rend compte que
l'on se trouve en fait dans le même monde que celui des orphelins
Baudelaire. Certaines références obscures (le narrateur est
volontairement mystérieux et laisse le lecteur dans l'ombre) seront
ainsi plus claires pour un lecteur de la série précédente.
Cependant, on peut tout à fait découvrir cet univers avec ce roman.
Attendez-vous simplement à un être un peu perdu au départ :
c'est normal, Lemony Snicket aime perdre ses lecteurs ! Il
faudra vous y faire !
En ce
qui concerne les personnages, on retrouve donc bien évidemment
Lemony Snicket lui-même. En effet, pour rappel, l'auteur est
également un personnage de l'histoire. Alors que dans les orphelins
Baudelaire il était adulte, il nous propose ici de découvrir son
enfance et ses débuts au sein de la fameuse organisation jamais
nommée mais qui n'est sans doute autre que VDC. Sa « voix »
d'enfant m'a ici moins convaincu que celle du Lemony adulte. En
effet, peut être à cause de son jeune âge, il est bien moins
sarcastique et grinçant que dans les orphelins (or, c'était un des
points forts de la série). En revanche, les autres personnages qu'il
décrit sont tout à fait à la hauteur ! Mention spéciale à
Theodora, sa mentor, qui illustre à merveille le sort réservé aux
adultes dans l'univers de Snicket : des personnes totalement
absurdes et ridicules !
Parlons
maintenant un peu de l'intrigue. Snicket oblige, c'est tarabiscoté,
mot signifiant ici « compliqué mais au final relativement
simple et obscurci par un traitement volontairement mystérieux et
allusif sur certains points ». Une histoire de vol,
d'enlèvement et mystérieux projets. Voilà en gros ce qui va vous
occuper dans ce roman. L'affaire policière se suit sans trop de mal
mais certains seront en revanche peut être énervé par les nombreux
silences volontaires du narrateur sur certains points qui ont pour
conséquence de nous laisser faussement dans l'ignorance. Comme dit
plus haut, il faut s'y faire, cela fait partie intégrante de
l'écriture de Snicket. Considérez cela comme une sorte de jeu :
à vous de réussir à mettre les pièces du puzzle dans l'ordre.
J'insiste sur ce point car c'est vraiment LE reproche que j'ai vu
plusieurs dans d'autres chroniques sur internet.
Pour
conclure, donc, un véritable plaisir que de retrouver un Lemony
Snicket en bonne forme. Le roman se lit facilement mais on ne peut
cependant s'empêcher de le comparer aux orphelins Baudelaire qu'il
ne parvient à mon goût pas à surpasser. Mais, pour sa défense, il
ne prétend pas tout à fait jouer dans la même catégorie. De plus,
il s'agit là d'un premier tome qui appelle bien évidemment une
suite à partir de laquelle il sera déjà plus aisé de commencer à
porter un jugement d'ensemble sur cette nouvelle série. Bonne
lecture !
7.5/10